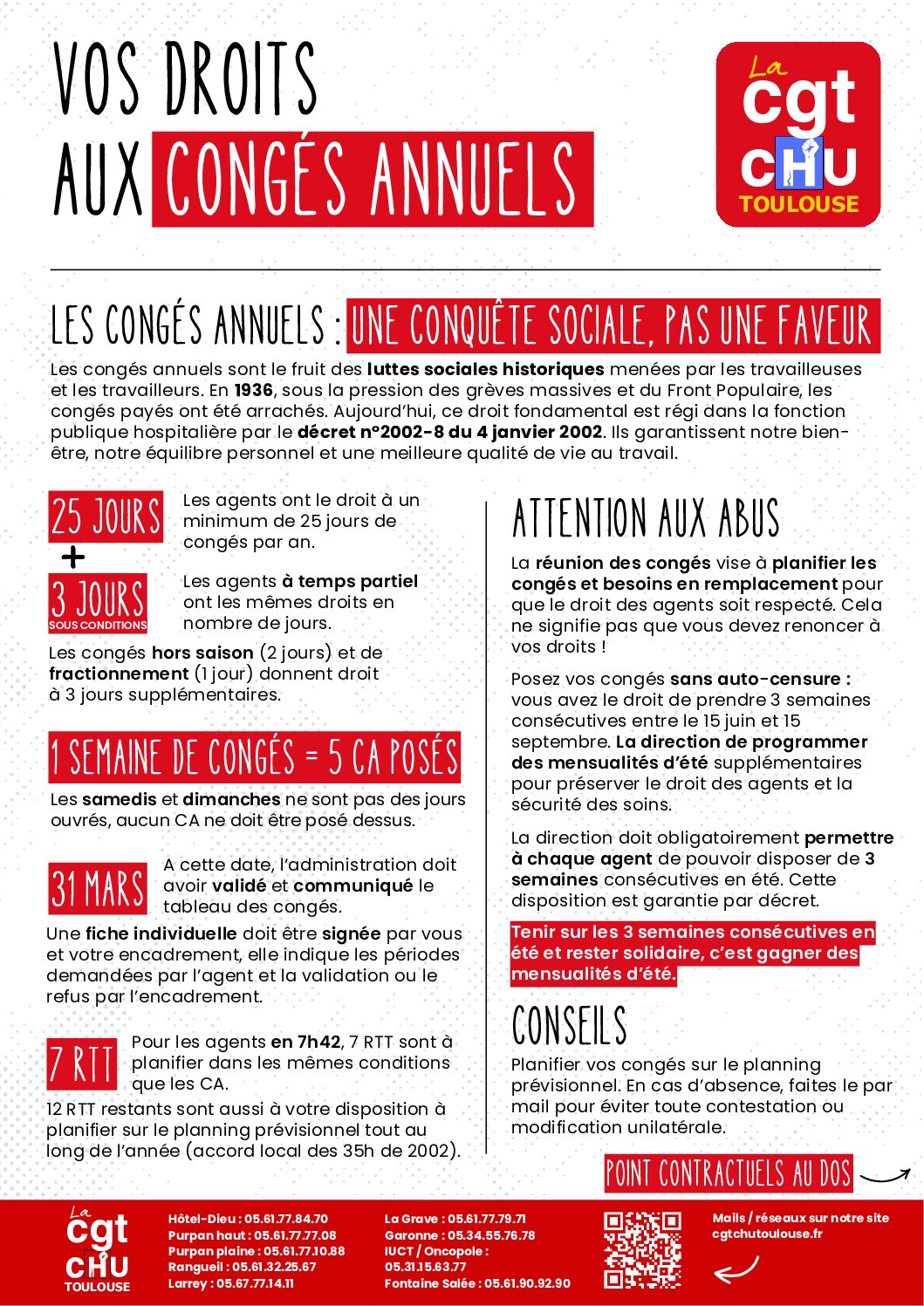La souffrance au travail [1] conduit à des pathologies de l’isolement. Mais, paradoxalement, elle est souvent partagée par plusieurs personnes dans le même lieu de travail au même moment pour des causes similaires.
La souffrance s’exprime par des intolérances psychologiques parfois violentes. Comme si les salariés victimes avaient intégré à tel point les contraintes qui s’imposent à eux que, dans une logique de culpabilité, ils avaient retourné l’adversité et la violence contre eux-mêmes. Cela conduit à une injustice inacceptable : les travailleurs, en souffrance, payent les effets des organisations du travail malades d’un « pur capitalisme »[2].
Les événements d’ordre psychosocial doivent alors interpeller les collectifs de travail : pour sortir du statut de victimes individuelles et isolées, il s’agit de réhabiliter la conflictualité et le rapport de force collectif pour la défense des conditions de travail et du contenu du travail. Cela appelle un débat sur le modèle de travail que l’on entend défendre qui interpelle le politique et l’économique.
En appelant ainsi à la conflictualité, nous sommes donc très loin des préconisations de la plupart des organismes institutionnels de santé au travail qui appellent au contraire à la « pacification » des relations de travail, à des approches « plurifactorielles » compliquées, à l’élaboration d’un « diagnostic partagé » (qui aboutit souvent à la domination d’un diagnostic particulier), gommant ainsi les antagonismes d’intérêts.
Nous faisons dans cet article l’hypothèse que la souffrance au travail est le résultat d’un processus par lequel le salarié « retourne » le conflit contre lui, en « intériorisant » les difficultés qu’il rencontre sous forme de culpabilisation et de désespoir. L’isolement empêche l’identification de l’origine de ces difficultés à l’extérieur de soi, dans le monde social et réduit les capacités d’élaboration de solutions adaptées. Les actions collectives sont seules vraiment en mesure de redonner du sens aux souffrances endurées et d’améliorer réellement les situations de travail.
L’approche patronale des risques psychosociaux repose en effet essentiellement sur la psychologisation et l’individualisation du problème[3] :
- Psychologisation : ce n’est pas la société ni les rapports sociaux qui sont mis en cause, mais le « profil psychologique » de la personne, avec son « stress », sa fragilité propre, son incapacité à mettre en valeur son « capital humain ». Les solutions préconisées mettront alors en avant les cellules psychologiques, les stages de sophrologie, la mise en place de « baromètres » …
- Individualisation : la personne est considérée isolément, hors du collectif. Ce dernier ne sera convoqué, au mieux, que pour assurer l’accompagnement des individus : évaluation et sélection des personnes, mise à l’écart en cas de problème, « écoute » des individus …
Psychologisation et individualisation s’opposent ainsi à l’approche sociale et collective.
En ce sens, il ne suffit pas de mettre en cause le « management » des entreprises. S’en tenir à cela reviendrait à rester prisonnier du versant « psychologisation/individualisation », sans vraiment toucher aux racines sociales et collectives des risques psycho-sociaux.
Et pour commencer, il faut remettre le travail au cœur des rapports de force, et reconnaître que quotidiennement les travailleurs y investissent leur intelligence. C’est alors rappeler l’enjeu de la dignité au travail et des valeurs que chacun est appelé à y défendre. Cela implique de la conflictualité.
Plus que jamais il faut soutenir l’idée que les travailleurs disposent d’une force considérable : celle de produire de la valeur sans laquelle le capitalisme ne peut vivre. Il n’y a d’ailleurs pas à douter que la contestation du modèle actuel de travail peut conduire à la contestation du système économique, et réciproquement. Ce qui se joue dans le travail aujourd’hui entre en effet en résonnance avec les débats sur la crise économique. Il faudrait corriger les excès du capitalisme qui conduiraient à la crise économique. Il faudrait corriger les excès de quelques entreprises et quelques managers qui par des comportements déviants mettraient en danger les salariés. Dans les deux cas, nous contestons l’idée qu’il suffirait de gommer ces quelques supposés excès ou « d’humaniser » le système à la marge, car cela ne résoudrait pas les antagonismes fondateurs du capitalisme sur le plan économique, ni dans le travail.
I – La finance n’obtient que ce que le travail lui donne
I-1 – Travail, économie, société
Le travail fait l’objet d’une double valorisation[4] :
- la valorisation économique au sens où le travail produit de la valeur économique. Dans le système capitaliste, cette valeur est partagée entre les travailleurs (les salaires) et les financiers (les profits) ;
- la valorisation de l’existence des travailleurs au sens où chacun y construit en partie[5] sa santé, sa place et son rôle dans la société. La valorisation de l’existence est alors tendue entre les pôles ambivalents du travail : émancipation / aliénation, fonction créatrice / fonction destructrice, plaisir / souffrance, amélioration /dégradation de la santé, …
Quand le travail change, ce sont les modalités de la valorisation économique et les modalités de valorisation de l’existence des travailleurs qui changent. On pourrait imaginer des évolutions harmonieuses (ex : la mécanisation pourrait réduire les contraintes des travailleurs et améliorer une performance économique mieux partagée) mais nous constatons, dans le système capitaliste, qu’elles sont souvent antagonistes. Par exemple, le constat de la croissance de nouvelles contraintes au travail est à relier à l’augmentation de la productivité et à l’augmentation du taux d’exploitation (captation de la valeur produite par le travail au profit du capital) mesurés par les économistes.
Mais, à moins de figer les travailleurs en position d’éternelles victimes, il nous semble important de rappeler que les relations entre économie et conditions de travail fonctionnent à double sens :
- D’un coté, les déterminants économiques (la mondialisation, la « libre » concurrence, le capitalisme, …) sont des causes explicatives majeures des maux du travail, notamment des risques psychosociaux. Certes ce constat pourrait vite désarmer, au regard de l’ampleur du projet d’action : face à la souffrance, proposer de transformer les structures du capitalisme représente un levier bien lointain. Pourtant, prévenir les risques psychosociaux sans requestionner le travail et donc l’économie, nous enfermerait dans l’impasse de l’adaptation des travailleurs aux contraintes de l’économie. Par la compréhension des mécanismes qui construisent la santé au travail (jusqu’à la maladie), par le combat pour l’amélioration des conditions de travail, par la réintroduction du sens du travail comme facteur de santé mentale, on tire nécessairement les fils d’une pelote qui nous conduit à mettre en question les structures économiques.
- D’un autre coté, la performance économique se construit sur ce que le travail et les travailleurs apportent. Ainsi, rappeler que la finance n’obtient que ce que le travail lui donne, débouche sur des perspectives d’action militante renouvelées : les travailleurs ne sont plus alors considérés comme les victimes du système, mais comme des protagonistes d’un affrontement social. En contestant l’organisation du travail, en créant sur le terrain spécifique du travail un rapport de force, on contribue aussi à contester le système économique.
Cela implique d’aller sur le champ politique puisqu’il y a des arbitrages collectifs à réaliser qui ne sont pas neutres sur la société : considérer (ou non !) que la souffrance est le sacrifice nécessaire que doivent consentir certains travailleurs pour garantir le taux de rentabilité du capital, relève, par exemple, d’un arbitrage politique. A l’échelle d’une entreprise, définir une organisation du travail, des stratégies commerciales ou de maintenance, des orientations de recrutement, … relèvent aussi du politique puisque cela aura des impacts sur le produit, le sens et le contenu du travail. Arbitrer cela selon des critères de performance économique et des critères de santé relève encore du politique.
Ainsi, penser le travail, c’est aussi accepter de penser le fonctionnement de la société et ce qu’il s’y crée comme bien-être ou mal-être social. Agir sur le travail, c’est donc aussi agir sur la société. Jacques Duraffourgle rappelait : « Aucun, je dis bien aucun, des problèmes qui se posent à notre société ne pourra être pensé sérieusement tant que le travail dans son contenu et pas seulement dans ses conditions ne sera pas au centre de tous les acteurs de notre vie politique, économique et sociale. Il n’y a pas de possibilité d’un « vivre ensemble démocratique », tant que les femmes et les hommes devront produire leur existence sous le joug d’un système socio-technique supposant, pour cause de rentabilité financière, une déréalisation de leur activité de travail. »[6]. Nous comprenons ici la « déréalisation » au sens d’un phénomène de perte de sens ou d’aveuglement : la perte de la compréhension ou le déni des liens entre le travail que l’on effectue et les effets de ce travail sur le monde qui nous entoure.
Ce faisant s’éloigne-t-on des risques psychosociaux ? Il nous semble au contraire que si l’on souhaite comprendre et combattre les phénomènes actuels de souffrance au travail, c’est cet ensemble de questions qu’il faut aborder, à moins d’en rester à une approche purement « psychologique » des risques psychosociaux et une démarche peu efficace de leur prévention.
I-2 – Un double mouvement d’augmentation du taux d’exploitation et de la productivité
Cidecos l’a montré dans de récents articles sur la crise financière[7], la part des revenus produits par le travail est de moins en moins affectée aux travailleurs et de plus en plus affectée au capital. Autrement dit, le taux d’exploitation a augmenté depuis 1981[8]. Autrement dit encore, la majeure partie des gains de productivité acquis depuis les années 1980[9] ne se traduit plus par une augmentation des revenus des travailleurs mais par une augmentation des profits des entreprises réattribués aux revenus du capital, donc aux actionnaires. Au sein même du salariat, les inégalités s’accroissent.
Ce double mouvement (gains de productivité, taux d’exploitation croissant) peut-il être sans conséquence sur les conditions de travail ? Tous les indicateurs globaux tendent à montrer une intensification du travail sur la même période. La réduction du temps de travail mise en œuvre dans les années 2000 n’a pas freiné ce mouvement d’intensification. Avec la RTT, la baisse de 10% du temps de travail de référence (qui s’est appliquée pour une partie des salariés) s’est souvent accompagnée de contreparties exigées aux salariés en termes de rythmes, de flexibilité et de charge de travail (pour ne pas trop grever les profits…), abandon d’acquis sociaux négociés par le passé …
Or, on rappelle que « la finance n’exige jamais (et ne prend) que ce que lui donne la production, donc le travail »[10]. Qu’est-ce que cela coûte alors au travail (et aux travailleurs) de produire plus et d’apporter plus des fruits de cette production aux capitalistes ?
II – Les instruments de la mobilisation du travail : l’enrôlement dans la guerre économique, la peur du chômage et l’individualisation
Le double mouvement d’augmentation du taux d’exploitation et de gains de productivité est fondé sur une stratégie de mobilisation du travail sans laquelle celui-ci ne serait pas en mesure de fournir ce qu’on attend de lui. Les formes actuelles de cette mobilisation sont un des moteurs des risques psychosociaux au sens qu’ils supposent un rapport belliqueux au monde, un sentiment d’insécurité permanente et une tentative d’isolement des individus au travail.
II-1. « Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent »[11]
Un directeur d’entreprise nous rappelait récemment en séance de CHSCT : « Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une guerre économique : les salariés ne sont pas uniquement exposés aux risques professionnels du travail, ils sont également exposés au marché libre et concurrentiel », rappelant ainsi la mise en concurrence des travailleurs et leur enrôlement forcé dans une « guerre économique » supposée inévitable. Si l’on pousse la métaphore belliqueuse, on comprend que chaque travailleur est en position de combattre son ennemi (et, pourquoi pas, de le tuer), au risque d’être lui-même battu et exclu de la compétition. Il y aurait nécessairement des gagnants et des perdants, on y reconnaitrait les forts et les faibles[12]. Dans une guerre, la fin justifie les moyens : on n’en exclut ni les victimes sacrifiées, ni les pratiques déloyales, ni la justification de l’injustifiable.
Or, qui sont ces concurrents à combattre ? Qui sont, précisément, ces ennemis virtualisés à abattre ? Personne d’autre que son collègue, son voisin travaillant dans l’entreprise concurrente, le salarié travaillant dans une entreprise sous-traitante, l’asiatique plus lointain mais tout aussi présent, et, bien-sûr, le chômeur à l’affût (« ne vous plaignez pas, beaucoup attendent à la porte »).
Bien entendu, céder au discours de la « guerre économique » consisterait à setromper d’ennemi. Dans cette guerre détournée, qui est avant tout celle du capital contre le travail[13], les seuls vrais vainqueurs sont ceux qui en tirent un dividende, les victimes sont ceux qui souffrent dans leur travail. L’idéologie belliqueuse vient alors heurter, au sein même du quotidien de travail, les valeurs de citoyenneté, de solidarité, de bien commun tout en nourrissant des violences au travail, en insécurisant les salariés par la peur et en justifiant la performance du travail sans limite et à tout prix.
En effet, le travail n’est pas une organisation froide, déterminée par ses seuls « inputs/ouputs ». Le travail est une organisation humaine et sociale, siège de débats de valeurs[14] qui renvoie à des débats de société. Dans le travail, chacun est appelé à arbitrer son action au sein de tensions entre des valeurs marchandes et des valeurs non-marchandes : productivité contre sécurité dans les industries à risques, rentabilité contre qualité, résultats économiques contre santé au travail, concurrence entre les travailleurs contre entraide et solidarités, … Or, quand les valeurs marchandes écrasent à tel point les valeurs non-marchandes, quand les choix de chacun sont entravés par des « buts de guerre » économiques mettant au second plan les valeurs de solidarité et de bien commun, le travail devient un espace pathogène.
| [Encart 1
Des débats de valeurs dans le travail : Nous rencontrons donc de plus en plus de salariés en souffrance de ne pouvoir inscrire le contenu de leur travail dans des valeurs humaines positives. Pour illustrer cela, nous retiendrons l’exemple de ce conseiller financier dans une banque qui n’en peut plus d’être pressé au quotidien par des objectifs qui le contraignent à fournir des produits financiers totalement inadaptés aux besoins de ses clients : « Dans mon métier de « conseiller financier », on me demande surtout de faire de la « finance » et surtout pas du « conseil ». On me demande de vendre des produits à des gens qui n’en ont pas besoin ; on me demande d’abuser de leur crédulité. J’ai honte de ce que je fais. » On retiendra également la « souffrance éthique » de personnels de maintenance appelés à encadrer le travail des sous-traitants (définir les travaux, négocier le contrat, évaluer le résultat) qui nous évoquent leurs difficultés à inscrire leur travail dans des valeurs qui leur conviennent : « Les prestataires n’ont vraiment pas un boulot facile : ils ont de plus en plus de contraintes, de moins en moins d’effectifs, ils sont de moins en moins formés, et nous on est là pour leur mettre toujours plus de pression. Je ne supporte plus d’être le garde-chiourme ! ».] |
II-2. « Dedans, c’est la galère ; dehors, c’est la misère »[15] ou le poids orchestré du chômage sur le travail
Par ailleurs, l’idéologie de la guerre économique est relayée par un discours d’insécurité de l’emploi à l’échelle individuelle (tous les salariés seraient menacés par la précarité, le risque de perdre son emploi) et à l’échelle collective (idée de déclin industriel par un phénomène de généralisation des délocalisations). S’il apparaît important de démystifier un certain nombre de phénomènes souvent exagérés[16] qui nourrissent les peurs tétanisantes, il n’en demeure pas moins une évolution des formes de travail qui tendent à se fonder de plus en plus sur de la précarité. Ainsi, l’actualité économique nous révèle comment le travail est instrumentalisé pour coller aux besoins du capital dans ses variations conjoncturelles : en situation d’affaiblissement de la demande, chômage partiel, réduction du recours au travail intérimaire et suppressions d’emplois ; en situations d’augmentation de la demande, heures supplémentaires, recours au travail intérimaire. La période dite « de crise » montre jusqu’où le climat d’insécurité permet de pousser la flexibilité. Par exemple, on utilise au même moment du chômage partiel ici, quand là, on a recours à des heures supplémentaires (parfois au sein d’une même entreprise, comme Peugeot actuellement).
Ces formes de mobilisation du travail insécurisent les travailleurs pour mieux en disposer quand on en a besoin. Dans cette logique, le chômage, comme « armée de réserve » est un levier de mobilisation extrêmement efficace pour contraindre les travailleurs à se rendre sans rechigner au travail quelles qu’en soient les conditions[17]. Le chômage n’a pas vocation à nous éloigner de l’emploi, en dépit des apparences, mais au contraire à assurer la mise au travail, aux conditions de l’employeur, grâce à un véritable chantage à l’emploi. Le travailleur n’ayant alors plus qu’à ravaler ses propres aspirations (« de quoi vous plaignez vous, nous vous donnons du travail … »). Les menaces de délocalisation jouent dans le même sens.
On aboutit alors à une situation véritablement pathogène avec d’un côté le sur-travail des salariés qui souffrent de travailler et de l’autre, le sous-emploi des travailleurs sans travail (les chômeurs) qui souffrent de ne pas travailler.
| [Encart 2 : Diviser pour régner : l’individualisation des relations de travail conduit à l’isolement
L’individualisation des relations de travail est un mouvement en marche : individualisation du contrat de travail orienté sur le modèle du contrat commercial et réduction des contraintes collectives sur le licenciement[18], individualisation de la rémunération (systèmes de rémunérations variables sur critères individuels de résultats), individualisation des relations hiérarchiques (entretiens annuels d’évaluation qui n’évaluent jamais le travail, mais uniquement le résultat du travail), individualisation de la progression et de la reconnaissance professionnelle (modèle de la compétence qui s’est substitué à celui de la qualification et de l’expérience), individualisation du système de formation professionnelle, … Si l’on relève parallèlement l’affaiblissement sinon l’absence des instruments collectifs (notamment de l’action syndicale) dans les entreprises, on aboutit à l’image d’un salarié isolé dans des collectifs de travail déstructurés. Bien entendu, ce constat d’individualisation serait à modérer : le collectif revient souvent là où on ne l’attend plus, la coopération reste le plus souvent nécessaire pour produire. Cependant ; l’affaiblissement des valeurs de solidarité dans le travail explique en partie l’émergence de la notion de stress comme nouvelle grille de lecture des situations de travail.] |
Toutes ces évolutions ont un impact sur la santé, en particulier dans le champ des facteurs psychosociaux :
- La prééminence des valeurs marchandes dans les critères de choix d’organisation du travail et le chantage à l’emploi tendent à rendre impossible toute discussion possible sur le travail (ses conditions et son contenu).
- Par la menace et la peur, on impose l’acceptation sociale de l’augmentation des contraintes au travail et leurs conséquences pathogènes.
- L’individualisation affaiblit les stratégies collectives de défense et isole les travailleurs dans leur souffrance.
- Mais la psychologisation à outrance tend à ravaler la souffrance au travail au rang de « maladie » (et elle apparaît bien comme telle), justiciable alors d’une approche médicalisée, purement clinique, voire génétique (ne va-t-on pas jusqu’à chercher le gène du suicide ?!), ou bien à grand renfort de « soutien psychologique ».
De fait, le « stress » s’est substitué à d’autres grilles de lectures plus collectives (l’exploitation). Le modèle du stress modifie notre regard sur le travail car, en empruntant les lunettes d’une approche individualisante, psychologisante et pathologisante, on peut croire que les travailleurs sont les seuls malades, quand c’est le travail qu’il faut soigner.
III – Le travail en crise
III–1. La difficulté de résister
On pourrait s’étonner qu’un tel mouvement de mobilisation croissante du travail au profit du capital ait été socialement accepté : pourquoi si peu de rébellions individuelles visibles et si peu de résistances collectives victorieuses ? On pourrait également poser la question, comme l’a fait Christophe Dejours, il y a plus de dix ans, de l’acceptation et de la banalisation du mal : « Pourquoi les uns consentent-ils à subir la souffrance, cependant que d’autres consentent à infliger cette souffrance aux premiers ? »[19]. Certains y répondent, selon nous à tort, en réactualisant La Boetie et la notion de « servitude volontaire »[20] : ce serait nier toutes les formes de résistances qui existent malgré tout, mais également les difficultés auxquelles s’affrontent ces résistances en germe. En effet, la contestation de la performance financière apparaît comme un sacrilège, même lorsque des questions de santé sont en jeu. Dans les entreprises, un autoritarisme réel se fonde sur une autorité insaisissable (absence apparente d’autorité des directions locales avec lesquelles les salariés négocient les conditions de travail) : « On n’y peut rien, c’est décidé au niveau du groupe, au niveau des actionnaires, on ne résistera pas à la concurrence, … ». Au niveau politique, c’est l’imposition idéologique du TINA « There Is No Alternative »[21] thatchérien étendu à l’Europe : « Il n’y a pas d’alternative » au système capitaliste. Il n’y aurait ainsi plus de conflit entre travail et capital : « nous sommes tous dans le même bateau ». Or, dans ce bateau, les dégâts du système se rappellent à nous sous la forme de la souffrance au travail de ceux qui rament, d’un côté, et de l’image « bling-bling » de la réussite de ceux qui bronzent sur le pont, de l’autre.
Par ce matraquage idéologique, fondé sur un réel éloignement entre les centres de décision et les centres de production,on tente d’ôter aux salariés toute raison d’agir et on lui soustrait la cible de ses luttes. Or la faiblesse du « pouvoir d’agir »[22] est un phénomène majeur d’explication des risques psychosociaux.
III-2. Entre la soumission et la résistance, le travail au quotidien : adaptation aux contraintes ou subversion de l’ordre établi ?
On peut souligner, malgré tout, l’existence de multiples formes de résistances quotidiennes aux nouvelles contraintes de travail. Si l’on examine l’histoire récente des résistances collectives depuis les années 80, on peut aligner des mouvements de contestation continus (quelquefois victorieux) qui n’ont jamais cessé. On relève même une augmentation de la conflictualité par un éclatement des modes de contestation qui la rend moins visible[23].
On peut également trouver des formes de résistance dans le quotidien de travail : « Toute une part de lacombativité humaine au travail […] Certains actes ou gestes, certaines paroles, en apparence insignifiants et qui ne font l’objet d’aucune publicité, voire qui l’évitent soigneusement, subvertissent pourtant « l’ordre établi » en concrétisant un « Travailler autrement » [et sont] les manifestations microscopiques d’un vivre et travailler autrement » [24].
En effet, nous savons depuis les études centrées sur l’analyse des activités de travail (ergonomie, sociologie du travail, psychologie du travail, …) que les activités de travail ne sont pas seulement le siège d’une exploitation économique (captation de la valeur produite par le travail au profit du capital) et ne peuvent se résumer à une unique logique d’oppression (soumission à une autorité excessive ou injuste). Lorsque l’on prend le temps de faire l’analyse des individus et des collectifs au travail on comprend lentement que le travail n’est jamais la stricte exécution des tâches telles qu’elles ont été prescrites ou prévues par ceux qui conçoivent le travail. Autrement dit, chaque personne au travail est toujours en situation de recréer son activité, d’inventer des réponses à des imprévus, d’imprimer son individualité dans ses actions, de rejouer les valeurs qui animent les collectifs.
Le travail est dans cette approche le témoignage d’une émancipation inscrite dans la condition humaine consistant à modifier les cadres, les règles, les normes de l’activité. Il ne peut d’ailleurs en être autrement, car la soumission complète aux normes est invivable, et la stricte application des procédures est impossible car improductive (ce qui Yves Schwartz appelle « l’impossible invivable des situations de travail »). Cependant, les transgressions (désobéissance à un ordre établi) ne sont pas nécessairement toutes des subversions (renversement de l’ordre établi). Certes, cela témoigne d’un affranchissement local vis-à-vis de l’ordre. Mais ces écarts peuvent au contraire contribuer à maintenir l’ordre établi, au lieu de le modifier, car ils en maintiennent fictivement la validité, tout en impliquant un coût pour les travailleurs[25].
Dès lors, le bien-être se construit sur le « pouvoir d’agir », le mal-être sur son absence :
- pouvoir agir sur son environnement local par la possibilité de transgresser l’ordre établi et de gérer ainsi les écarts entre le travail tel qu’il est prescrit (par l’encadrement, les normes, les procédures) et le travail tel qu’il se réalise concrètement ;
- mais aussi pouvoir agir plus globalement sur le travail, c’est-à-dire reconnaître aux transgressions le pouvoir de subversion de l’ordre établi et conduire ainsi à des transformations du travail (organisation, conditions de travail, sens au travail).
| Encart 3 :
Travail prescrit, travail réel et risques psycho-sociaux
Il nous semble essentiel d’aborder les risques psychosociaux par les différentes formes de crise que peut rencontrer la gestion des écarts entre le travail prescrit et le travail réel car, en arrière-fond, se dessinent les crises du « pouvoir d’agir » :
Dans toutes ces situations, les stratégies économiques percutent la réalisation concrète du travail et sont source de difficultés pour les travailleurs. Cela renvoie à une question fondamentale en matière de santé : puis-je agir avec un relatif succès sur mon environnement ?] |
III-3. La santé se construit sur le « pouvoir d’agir ».
On peut définir la santé au travail à la manière dont le philosophe (et médecin) Georges Canguilhem décrivait les trois composantes sur lesquelles reposait le fait de « bien se porter » :
- « se sentir capable de porter la responsabilité des mes actes,
- de porter des choses à l’existence
- et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi »[27].
Autrement dit, et pour simplifier, la santé se construit sur la possibilité d’agir sur l’univers dans lequel je vis, sur la possibilité de modifier les normes qui instruisent le milieu dans lequel je vis. Ici, c’est agir sur mon environnement de travail quotidien : agir sur la définition de mon poste de travail, avoir un impact sur l’organisation du travail, être entendu au sein de mon collectif de travail et par ma hiérarchie, trouver des idées, etc. Agir sur mon univers de manière plus large, c’est la possibilité d’agir sur le sens et l’aboutissement de mon travail et sur la société en général : Quelle est l’utilité sociale de mon travail ? Quelles sont les « valeurs » que je défends dans les manières que j’ai de travailler ou dans l’idée que je me fais de ce qu’est un travail de qualité ? … Au final, cela construit le rapport vertueux au travail : est-ce que je parviens à me « regarder dans les yeux de ma propre activité de travail »[28] ?, selon l’expression de Yves Clot.
A l’inverse, le bien-être est compromis lorsque ces possibilités d’agir sur mon environnement sont contraintes, réduites, empêchées : certains salariés ont le sentiment que les contraintes économiques s’imposent à leur quotidien de travail et laissent peu de marge de manœuvre ; des salariés expriment de la souffrance à l’idée qu’ils n’ont plus les moyens de réaliser un travail de qualité ; d’autres se sentent impuissants face à des prises de décision réalisées dans des sphères insaisissables ; dans les situations les pires, des salariés ont le sentiment d’être entièrement isolés face à tout ce qui s’imposent à eux.
Face à ces difficultés, différentes options plus ou moins contraintes sont envisagées :
- On relève, d’une part des stratégies qui consistent à intégrer les contraintes et, pour maintenir un travail de qualité malgré tout, à « prendre sur soi », au risque de l’usure. Le cas classique est celui du surinvestissement.
- On relève d’autre part, des stratégies de retrait du travail, par des formes de renoncement que représente la démobilisation de certains travailleurs qui finalement en souffrent.
- On relève des situations extrêmes, « impossibles » donc à terme « invivables » : la seule issue d’une situation sur laquelle on ne peut plus agir est alors l’échappatoire par la maladie, ou le suicide.
- On identifie enfin l’option de la démission qui représente une forme individuelle de reprise de pouvoir sur son rapport au travail, mais qui est dépendante des possibilités de rebond vers une situation – professionnelle ou non – considérée comme plus favorable.
Ainsi, l’expression de la souffrance au travail par les risques psychosociaux est en quelque sorte une alerte à laquelle il faut être attentif : on tombe malade du travail parce que les conditions dans lesquelles on travaille sont tellement contraintes qu’on ne parvient plus à en faire un espace de construction de sa santé, jusqu’à arriver au point limite de ne plus pouvoir se maintenir dans son travail. En soi, la maladie apparaît alors comme une forme ultime d’échappatoire individuelle : le corps dit « stop », on arrête de se maintenir dans une situation de travail délétère. Mais la maladie d’origine professionnelle d’une personne est l’échec de l’ensemble du collectif car elle interpelle la souffrance inavouée des autres et l’impossibilité du collectif à s’organiser pour trouver des solutions collectives aux difficultés.
III-4. Les contradictions du capitalisme : la quête d’un travailleur au cerveau partiel
Ces notions de « pouvoir d’agir » et de gestion des écarts entre le travail prescrit et le travail réel, interrogent alors le système économique : quelle est la figure du travailleur que le capitalisme attend ? D’un côté, on relève que le capitalisme recherche un travailleur suffisamment intelligent pour produire efficacement. De l’autre, il recherche un travailleur suffisamment « peu intelligent » pour se soumettre sans contester ses fondements. Le grand écart (soyez intelligent mais ne le soyez pas) comporte des limites.
Le capitalisme a besoin de travailleurs car il a besoin d’intelligence au travail pour créer de la valeur (même dans les travaux qui apparaissent comme les plus « simples »). Certes, l’industrialisation a bien tenté de gommer le « facteur humain » de son procès de production par la mécanisation, mais il a toujours fallu des « cerveaux » pour les concevoir, les conduire et les réparer. Taylor, théoricien de l’organisation scientifique du travail, porte d’ailleurs ces contradictions. Il se prend à rêver d’un travailleur impossible, un « gorille intelligent », suffisamment intelligent pour ressembler à un homme et être capable de travailler (sur des tâches simples, d’où la parcellisation du travail associée au taylorisme), mais aussi suffisamment peu intelligent pour agir sans être tenté de penser sa situation de travail ou verser vers ce que Taylor identifie comme ses tendances naturelles à la flânerie. Pourtant, c’est aussi Taylor qui a compris qu’il y avait une intelligence et des connaissances au travail ; pour les maîtriser il fallait acquérir les connaissances des travailleurs et briser le monopole des travailleurs sur la connaissance du travail, ce qui leur permettait jusqu’alors de ralentir la cadence.
Dans les organisations actuelles du travail, au fond, cette contradiction est maintenue. Certes, on nie de moins en moins ouvertement l’intelligence au travail, mais on tente de la mobiliser de manière ciblée sur la performance localement productive et de l’évacuer pour tout ce qui touche la stratégie d’entreprise, le sens du travail, les valeurs défendues dans le travail. C’est intenable, car « il est évidemment désagréable que l’homme ne puisse s’empêcher de penser, souvent sans qu’on le lui demande, toujours quand on le lui interdit »[29].
Ainsi, le capitalisme impose une forme d’aliénation du travail dans sa volonté de soumission des travailleurs au régime de production de la valeur avec les conséquences que cela peut avoir sur la souffrance au travail et l’injustice sociale. Mais à l’inverse, et en bonne dialectique du maître et de l’esclave, on peut considérer que le capital est lui-même aliéné au travail, aux travailleurs et à leur intelligence. Sans le travail, sans les travailleurs et sans leur intelligence, il ne peut espérer aucune production de valeur. En ce point encore, l’émergencede la thématique des risques psychosociaux peut apparaître comme une limite au degré d’exploitation que le capital peut imposer au travail.
IV – Quand les travailleurs s’arrêtent de travailler : de l’arrêt individuel à l’arrêt collectif
Dans les débats sur la prévention des risques psychosociaux qui animent aujourd’hui jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir économique et politique, certaines voix se font entendre autour du coût que peuvent représenter ces pathologies pour la société (et éventuellement pour les entreprises) ; on évoque des coûts directs et indirects associés au stress, mais de manière plus radicale, on peut retenir l’impact important que pourrait représenter une généralisation des phénomènes de démobilisation au travail.
| Encart 4 :
La fausse piste du coût pour les entreprises Plusieurs études ont porté sur le « coût du stress »[30] et aboutissent à des évaluations. Il manque néanmoins dans ces études une dimension essentielle : le stress rapporte aussi. Il serait illusoire de penser que les directions d’entreprises seraient suffisamment aveugles et « idiotes » pour laisser ouvert depuis des années un gisement de rentabilité que représenterait pour elle le supposé « coût du stress ». Ces études s’appuient sur les facteurs de coûts que représentent les effets du stress : arrêts maladie, absentéisme, turn-over, accidents du travail, remplacement nécessaire du personnel, réorganisation du travail, baisse de la productivité, etc. Elles aboutissent à des estimations variables. Par exemple, le bureau international du travail (BIT) évalue le coût du stress entre 3et 4% du PIB dans les pays industrialisés, ce qui amenait Xavier Bertrand, alors ministre du travail, à évoquer un coût global pour la France de l’ordre de 60 milliards d’euros. Cette estimation reste un argument faible : certes, on peut évoquer des coûts associés aux effets sur la santé des travailleurs et sur la performance des entreprises. Cependant, la gestion de ces effets sur la santé des travailleurs génère aussi du PIB ce qui n’est pas mesuré. En témoigne par exemple l’activité croissante des cabinets de conseil des directions d’entreprise sur les questions du stress[31], mais également l’explosion du marché de la santé médicale et paramédicale qui prétend « soigner les stressés » (depuis les tisanes jusqu’aux massages dans des « no stress center »). Surtout, le stress est aussi un instrument de mobilisation maximale de l’homme au travail qui permet d’imposer en force aux travailleurs toujours plus de productivité et de rentabilité. Certes cela a un impact délétère sur la santé, mais il n’y a aucun doute que si les coûts induits par les effets des risques psychosociaux étaient supérieurs à ce qu’ils rapportent, les entreprises auraient abandonné ces modes de mobilisation des hommes au travail.] En revanche, l’argument du coût pour les entreprises apparaît vraiment quand on passe un seuil : celui d’un mouvement collectif d’arrêt de travail (ou de démobilisation au travail).] |
A l’heure actuelle, nous assistons à des formes d’intolérance aux contraintes qui se traduisent par des maladies ou des formes de démobilisation (désengagement), c’est-à-dire autant de stratégies plus ou moins conscientes, et le plus souvent individuelles, pour se sortir du travail.
Face à ces situations d’expression de la souffrance au travail, on relève que certaines directions d’entreprises commencent à être très mal à l’aise pour trois raisons principales :
D’abord, les directions d’entreprise se retrouvent face à un phénomène qu’elles ne savent pas (pour le moment) maîtriser ni endiguer, et en tous cas, beaucoup moins que lorsque la limite de l’acceptation sociale se traduisait par une expression revendicative formelle animée par des organisations syndicales identifiées, permettant une sortie de crise négociée à l’issue de laquelle on pouvait compter les points. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si les directions se retournent souvent vers les organisations syndicales dans des « groupes de confiance », ou autres « comités contre le stress au travail » pour aborder la question. Elles sont néanmoins face à une problématique insoluble : comment réduire les effets délétères visibles sans remettre en cause l’organisation du travail. Il ne reste alors plus qu’à « mieux communiquer », « mieux prioriser », « humaniser le management », ou autres talismans managériaux auxquels personne ne croit vraiment. Le levier exposé est souvent celui du management, positionnant l’encadrement sur des registres encore plus intenables qu’ils ne l’étaient déjà. On leur demande de maintenir les résultats, la pression, mais sans effet nocif. Cela va jusqu’à à des pratiques des plus infantilisantes et inefficaces que l’on n’oserait même pas imaginer si nous ne les avions rencontrées : organisation de « pêche à la ligne », petits cadeaux de pacification (peluches disposées dans les bureaux), …
Ensuite, les phénomènes de mal-être, dans leurs versions les plus dramatiques (en particulier, les suicides ou tentatives de suicide) nuisent à l’image de l’entreprise à l’heure où l’on affiche sa volonté d’un développement durable et d’une responsabilité sociale de l’entreprise. On peut rapidement constater que ce point n’affecte qu’à la marge la communication des entreprises qui maintiennent un discours lénifiant et n’abordent pas le sujet des risques psychosociaux en dehors de leurs murs[32]. Les directions commencent souvent par mettre en place des dispositifs qui visent à identifier les situations individuelles à risque pouvant potentiellement conduire à un suicide. Il s’agit avant tout pour elles de se garantir un filet de sécurité pour éviter les actes les plus ultimes et les plus médiatisés, ce qui, au passage nous semble particulièrement difficile : les tentatives de suicides ont le plus souvent lieu, justement parce qu’elles sont difficilement anticipables par les personnes qui entourent la victime.
Mais plus profondément cela comporte le risque de grever les revenus attendus du travail.Quand les travailleurs commencent à se désengager de leur travail, à travers des stratégies d’évitement (ce qui, néanmoins, n’est pas sans effet retour sur leur santé à moyen terme) cela pose un vrai problème aux capitalistes car sans travailleur, pas de travail, ni de revenu du travail à distribuer au capital. Nous avons rencontré des services entiers qui optent pour une stratégie de grève de zèle, qui refusent de réaliser les tâches qu’on leur demande de faire, qui refusent de former les nouveaux arrivants. Ces dérives pénalisent rapidement la performance de l’entreprise qui a besoin de collectifs produisant de la valeur et qui ne parvient pas à mobiliser les salariés : les discours sur les valeurs de l’entreprise, les plans de performance, la menace de la concurrence locale et internationale ne fonctionnent alors plus. En général, on change le manager coupable de n’avoir pas su « gérer » ses ressources et souvent lui-même victime de situations de travail délétères, mais c’est rarement suffisant. Seule une réflexion collective et une action sur le travail, sans volonté d’esquive des sujets qui fâchent (effectifs, charge de travail, contenu du travail, finalités du travail, reconnaissance du travail, …) est selon à même de remettre sur pied des collectifs qui tentent désespérément de se désengager du travail (tel qu’il est).
| Encart 5
Conflictualité et bien-être Lors d’une étude globale sur les risques psychosociaux d’une entreprise d’un millier de personnes, les résultats que nous obtenions après enquête montraient que le service qui apparaissait comme le moins exposé aux risques psychosociaux était celui dans lequel il y avait eu le plus de conflits sociaux ouverts. Ces conflits portaient sur l’emploi (augmentation des effectifs pour travailler dans de meilleures conditions et enjeu de renouvellement des futurs départs en retraite) et sur les salaires (reconnaissance d’activités à fort enjeu de sûreté). Comment pouvaient-ils à la fois se plaindre de leurs situations de travail et apparaître les moins exposés aux risques psychosociaux ? Nous interprétions ce paradoxe apparent à travers la force du collectif : le collectif professionnel étant très fort, animé par des règles de métier fédératrices, les salariés étaient d’abord en capacité d’exprimer la nature des difficultés dans leur travail (laissant ainsi peu de place à la culpabilisation individuelle) ; ils parvenaient ensuite à élaborer collectivement des revendications précises ; enfin, le collectif manifestait sa conviction avec force à travers des mouvements de mobilisation quasi-unanimes dans le service. Deux ans après, nous constatons un service au collectif professionnel toujours dynamique, qui a obtenu des avancées sur les emplois, mais pas (encore ?) sur les salaires. |
CONCLUSION : réhabiliter la conflictualité collective
On a vu que l’augmentation de l’exploitation au travail (via l’intensification notamment) a ouvert des gains de productivité et nourri l’augmentation des profits ces 25 dernières années. Cela a pu se développer par des instruments de mobilisation au travail de plus en plus violents : l’idéologie belliqueuse de la guerre économique, le chantage a l’emploi et les instruments d’individualisation nourrissent une concurrence fictive des travailleurs entre eux et conduisent à des isolements au travail particulièrement pathogènes.
Certes, il existe des résistances locales, des tentatives permanentes d’émancipation qui permettent de survivre au travail. Certains collectifs de travail parviennent à maintenir des solidarités et défendent leur métier. Des syndicalistes défendent corps et âmes les conditions de travail. Cependant, on fait le constat de reculs à l’échelle globale et de certaines situations locales très préoccupantes, parfois dramatiques. Les crises du travail sont à la source de la souffrance : quand le travail perd de son sens, quand on a le sentiment de ne plus rien pouvoir changer les choses, quand on ne parvient plus à contester ou même modérer collectivement ce qui s’impose à nous, les ultimes échappatoires sont alors la maladie voire le suicide.
On le répète : le capitalisme a besoin du travail et des travailleurs pour produire de la valeur. Tantque la souffrance s’exprime individuellement, les dégâts, que le système capitaliste a lui-même produit, ne le menacent pas vraiment puisque ces dégâts lui coutent moins qu’ils ne lui rapportent. Mais lorsque les souffrances individuelles s’expriment par la contestation collective, notamment par l’arrêt de travail, alors le système perd ce qu’il peut espérer soutirer du travail.
Face au primat patronal « individualisation et psychologisation », il convient de réaffirmer la nature sociale des difficultés rencontrées et la nécessité de réponses collectives, tant dans leur élaboration que leur réalisation.
Nous avons fait dans cet article l’hypothèse que la souffrance au travail est le résultat d’un processus par lequel le salarié (à son corps défendant) retourne le conflit contre lui, en intériorisant les difficultés qu’il rencontre sous forme de culpabilisation et de désespoir. C’est alors l’individu qui se vit en échec personnel. A l’inverse, en identifiant l’origine du problème à l’extérieur de soi, dans tout le monde social, on peut à la fois « extérioriser » sa souffrance et trouver le chemin de l’action collective qui seule sera vraiment en mesure de redonner du sens aux souffrances endurées et d’améliorer réellement les situations de travail.
Ainsi, face aux risques psychosociaux, le syndicalisme a un rôle majeur à jouer dans ses instances représentatives (CHSCT, CE) et dans sa fonction de construction collective de la contestation d’un ordre établi pathogène. Il s’agit selon nous :
1- d’imposer le syndicalisme comme force d’action pour aborder la souffrance individuelle dans les entreprises et ne pas laisser le patronat écarter les « malades de l’emploi » sans soigner d’abord le travail.
2 – D’orienter les salariés sur l’examen collectif de leur propre travail afin d’identifier les mécanismes collectifs et sociaux qui génèrent la souffrance exprimée individuellement.
3 – de revendiquer avec force l’amélioration du travail, de ses conditions, de son contenu, de son sens, c’est-à-dire reprendre au capital ce qu’on lui a donné jusqu’à présent, même par petits bouts.
Parce que des logiques antagonistes s’opposent à chaque moment dans tout travail, son amélioration est nécessairement un objet de conflit. Dans ce conflit, il s’agit d’armer le rapport de force en faveur du travail : chaque gain en termes d’amélioration du travail, aussi petit soit-il, portera en lui-même la contestation du capitalisme dans ses fondements et la revendication d’une société guidée par la préoccupation du bien-être de tous.
Il faut donc réhabiliter le conflit social, c’est la meilleure des thérapies, psychologiques … et sociales !
Erwan JAFFRÈS
Raphaël THALLER
[1]Cet article est une version légèrement remaniée d’un article paru dans Droit d’Alerte, n°10, novembre 2009 consacré aux risques psychosociaux.
Raphaël Thaller est le directeur de CIDECOS et Erwan Jaffrès y est chargé d’études. CIDECOS est un cabinet d’expertises économiques et conditions de travail intervenant, à la demande des Comités d’Entreprise (CE) et des Comités Hygiène Sécurité Conditions de Travail (CHSCT), essentiellement dans le secteur de la chimie, pétrole, pharmacie. CIDECOS publie dans Droit d’Alerte des articles sur l’économie et le monde du travail, notamment à partir des enseignements tirés des expertises réalisées.
[2]Michel Husson (2008), Un pur capitalisme, Editions Page Deux.
[3]Ces derniers mois on relève que les lignes bougent un peu dans les discours patronaux mais ces discours ne sont pas suivis d’actions concrètes sur l’organisation du travail dans les entreprises de notre connaissance.
[4]Voir Jacques Duraffourg, « L’ergonomie et le contexte socio-économique », XXXIIème congrès de la SELF, 1997.
[5]« en partie », parce que le travail, même s’il tient une place majeure dans notre société, n’est pas le seul espace de construction de son existence (ceux qui ne travaillent pas n’existeraient alors pas !). On peut élargir la proposition à toutes les formes d’activités humaines en dehors de l’emploi (activités sociales, sportives, familiales, …) qui ne sont pas régies par les mêmes déterminants économiques.
[6]Duraffourg Jacques (2007), « Le travail nié, le travail relégué, le travail dévalorisé, … à quand le travail libéré ? », L’Humanité, 15 mai 2007.
[7]« Droit d’Alerte » numéros 7 et 8. Voir aussi les tirés à part sur la crise économique (février 2009) et le partage des profits (mars 2009).
[8]En France, la part salariale des revenus produits par le travail est passée de 66,5% en 1982 à 57,2% en 2005, soit une perte de 9,3 points pour les salaires, et un gain équivalent pour les revenus du capital. NB : c’est un mouvement similaire et dans les mêmes proportions que l’on retrouve à l’échelle européenne.
[9]Entre 1975 et 2004, la productivité horaire apparente a augmenté de 2,2% par an en moyenne, soit une multiplication par 2,3 sur la période (INSEE).
[10]« Droit d’Alerte », n°8.
[11]Jean-Paul Sartre (1951), Le diable et le bon dieu.
[12]On mesure vainqueurs et vaincus à coups de benchmark, mais on évalue également les salariés au quotidien : objectifs sans cesse renouvelés, résultats du travail mesurés sans prise en compte de ce que cela mobilise pour les atteindre, productivité des travailleurs comparée, …
[13]Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre la formule par Warren Buffet, considéré comme l’homme le plus riche du monde en 2008 : « Il y une lutte des classes, c’est entendu, mais c’est la classe des riches, ma classe, qui la mène et nous sommes en train de la gagner », New York Times, 26 novembre 2006.
[14]Yves Schwartz (1998), « Concordance des temps ? Le travail, le marché et le politique », in Le paradigme ergologique ou un métier de philosophe, Octarès.
[15]Slogan de AC ! (Agir ensemble contre le chômage) qui soulignait à la fin des années 90 comment la pression du chômage rendait possible l’augmentation de la précarité et des contraintes du travail.
[16]Voir « Droit d’Alerte », n°5, « Sur le présumé “irréversible déclin” des industries chimiques en France ».
[17]On le voit dans les périodes de baisse de chômage où les organisation patronales s’inquiètent très rapidement des risques de « pénuries de main d’œuvre » et des risques d’inflation de demandes d’augmentation de salaires…
[18]Voir « Droit Alerte », n°2.
[19]Christophe Dejours (1998), Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Seuil.
[20]La Boétie (1549), Le discours de la servitude volontaire, ou le Contr’un, dans lequel il de demande pourquoi« tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent ? ». Il l’explique par la « servitude volontaire » des sujets, fondée sur « l’habitude » (les sujets n’ont rien connu d’autre), l’idéologie ou les « drogueries » (jeux, théatres, religions, …), et surtout un ordre social pyramidal dans lequel les « courtisans » sont un instrument du maintien de la tyrannie. Comment se libérer ? : « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. ». On est ici bien entendu en plein idéalisme.
[21]Slogan de Margaret Thatcher, laissant entendre qu’il n’y avait pas d’alternative au libéralisme après l’effondrement du bloc communiste.
[22]Yves Clot, Le pouvoir d’agir, PUF, 2008.
[23]Voir Baptiste GIRAUD (2008), « Extension des domaines de la lutte », Droit d’Alerte, n°6, février 2008.
[24]Efros Dominique et Schwartz Yves (2009), « Résistance, transgression, transformations : l’impossible invivable des situations de travail », Nouvelle revue de Psychologie, n°7, Avril 2009.
[25]Par exemple, nous voyons souvent des politiques financières conduisant à réduire les stocks de pièces de rechange sur les sites. Les acteurs locaux, confrontés à des problèmes d’approvisionnement (faible réactivité, pièces de rechange inadaptées, …) en viennent souvent à s’aménager des « magasins pirates » (par différentes manœuvres, on stocke des pièces de rechange dans les tiroirs de bureaux ou dans le fond des ateliers). Ces stocks occultes sont le plus souvent connus des encadrements locaux : on décide de fermer les yeux car tout le monde en reconnaît implicitement l’utilité immédiate. Mais, ces stratégies, si elles permettent aux travailleurs à court terme de continuer à faire leur travail avec un sentiment d’aboutissement, si elles permettent de maintenir une performance productive, maintiennent en même temps une apparente validité de choix économiques pourtant contestables. Combien de temps cela peut-il durer ?
[26]La figure classique est celle du travail à la chaîne sur des tâches standardisées illustrée par Chaplin dans les Temps Modernes : Charlot doit visser des écrous passant sur la chaîne avec une clé dans chaque main. Il « coule » l’ensemble de la production au moindre aléa (une mouche perturbatrice, une clé qui bloque surl’écrou, …) ce qui l’amène à se battre à coup de pieds au derrière avec son collègue pendant que la chaîne continue de tourner, montrant ainsi les dangers (psychosociaux ?) de l’absence de solidarité ouvrière. Charlot finit par devenir fou, maintenant les gestes saccadés de sa tâche même quand la chaîne s’arrête. Il finit par se faire avaler par la machine.
[27]Citation de plus en plus reprise de Georges CANGUILHEM (2002), Ecrits sur la médecine, Seuil
[28]Yves Clot, Conférence prononcée le 4 décembre 2008, à l’université de Lyon 2 et organisée par le Groupe de Recherche en Psychologie Sociale.
[29]Canguilhem, cité par EFROS et SCHWARTZ (2009), Op. Cit.
[30]Voir par exemples les études de l’INRS sur le sujet, www.inrs.fr [3]
[31]Outre les classiques plateformes téléphoniques psychologiques, les formations au coaching humain, ces cabinets font preuve d’innovations. La dernière en date est édifiante : un prestataire de services propose aux entreprises des « tickets psy », fonctionnant comme les tickets restaurant. Quiconque se sent en difficulté peut recueillir un « ticket psy » anonymement, ce qui lui ouvrira la possibilité de consulter un psychologue du travail gratuitement – la consultation étant payée par l’entreprise…
[32]Ce sont souvent les organisations syndicales qui médiatisent les drames du travail (EDF, Renault, France-Telecom, …) et on ne manque jamais de le leur reprocher : « vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis ».