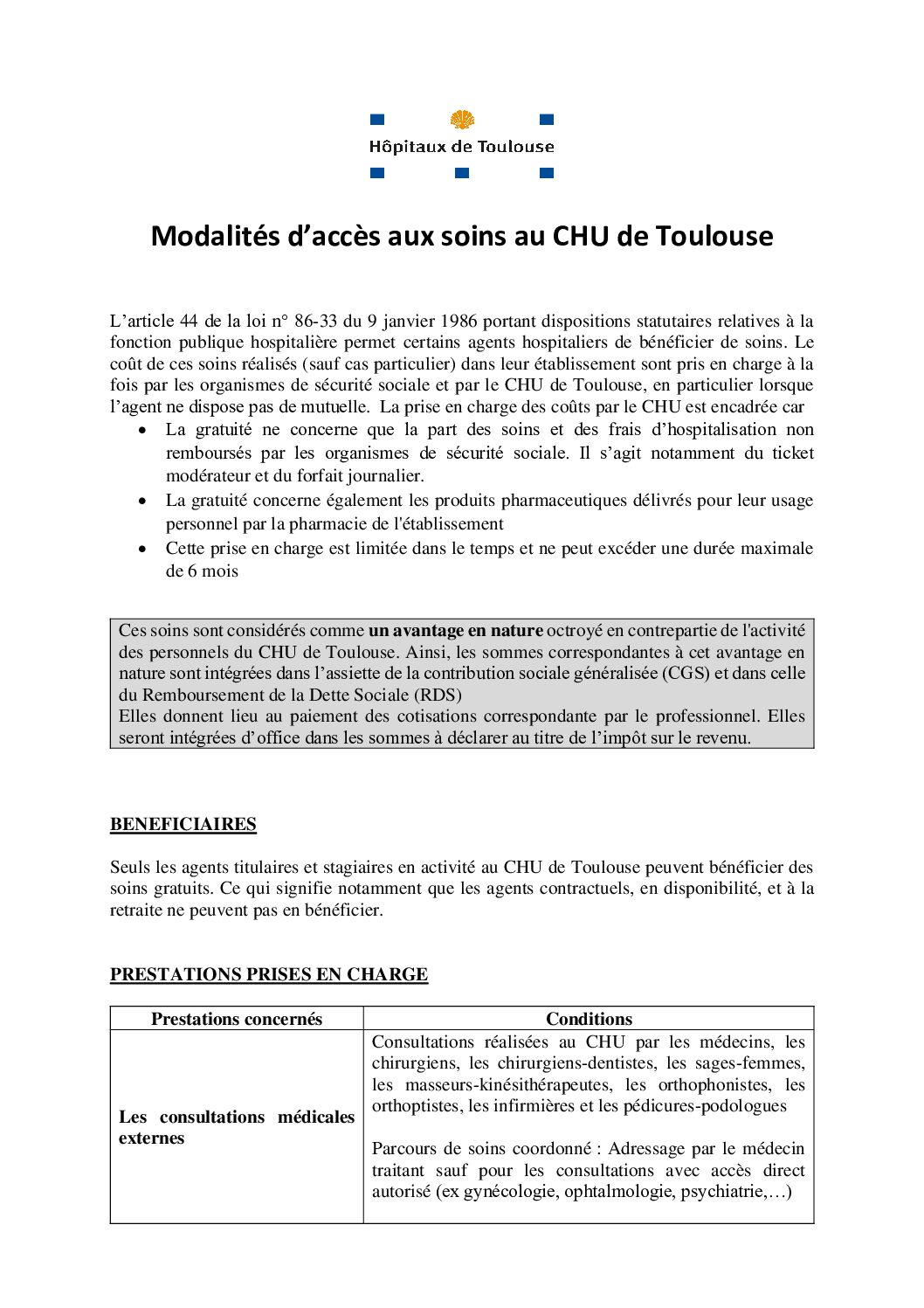05 août 2013 | Par Mathilde Goanec – Mediapart.fr
Elle avait disparu depuis 1974. La malaria fait son retour en Grèce, au centre et au sud du pays, comme le montrent les chiffres collectés depuis quatre ans. Cette maladie parasitaire, appelée aussi paludisme, est d’ordinaire surtout présente en Afrique, qui concentre 90 % des décès. Mais la désorganisation du système de santé a un impact sur le développement ou le retour de certaines maladies dans nos contrées. « À cause de son climat, de la proximité entre les moustiques et la population, la Grèce et d’autres pays méditerranéens sont vulnérables quant à une réimplantation de la malaria, met en garde Apostolos Veizis, chef de l’opération de soutien médical de Médecins sans frontières en Grèce. La défaillance du système de santé publique et de surveillance de la malaria est pour nous l’un des facteurs de sa réapparition. »
C’est d’autant plus préoccupant que les recherches sur les traitements antipaludiques sont toujours insuffisantes, malgré une accélération des investissements et des financements via les programmes gouvernementaux. « On estime à 5,1 milliards de dollars la somme nécessaire chaque année entre 2011 et 2020 pour atteindre l’accès universel aux traitements antipaludiques. En 2011, seuls 2,3 milliards de dollars étaient disponibles, moins de la moitié de ce qui est nécessaire, selon Apostolos Veizis. Les patients partout dans le monde ont besoin de médicaments peu coûteux, efficaces et bien adaptés. »
Grèce, mais aussi Portugal ou Espagne… Les systèmes de santé de l’Europe du Sud souffrent de coupes franches depuis le début de la crise économique de 2008. En France, les épidémies de rougeole constatées ces dernières années semblent être dues à une remise en cause, par certaines catégories de la population, du principe de protection vaccinale. Mais l’exclusion des soins et des campagnes de vaccination des plus vulnérables est aussi un puissant vecteur de transmission des maladies infectieuses.
- « Les foyers de tuberculose sont aussi liés à la désorganisation des systèmes de santé », estime Bernard Meunier de l’Académie des sciences :
Avons-nous déjà oublié les « tubards », fragiles et pâles, crachant du bacille à tout-va ? Avec l’amélioration des conditions de vie et la systématisation du vaccin au milieu du siècle dernier, les malades de la tuberculose ont quasiment disparu de nos radars sanitaires. La prévalence dans l’Hexagone est aujourd’hui seulement de 8 malades pour 100 000. « C’est très faible bien sûr, commente Jeanine Rochefort, bénévole pour Médecins du monde (MDM) en région parisienne. Mais aucune maladie, à part la variole, n’est définitivement éradiquée. La tuberculose peut revenir du jour au lendemain. »
À Saint-Denis, qui abrite un centre de soins MDM pour les plus vulnérables, migrants et Roms en particulier, les chiffres sont là pour le rappeler : la prévalence de cas de tuberculose est dans le département de 30 pour 100 000, ce qui est quatre fois supérieur au reste de la France. Jeanine Rochefort s’alarme de l’indifférence qui entoure ces malades : « Quand ça touche un voisin, tout le monde s’émeut. Mais les étrangers, c’est autre chose… Pourtant, je peux vous dire que les autorités connaissent le danger : on a vu des CRS porter des masques pour expulser un camp de Roms où plusieurs personnes étaient en cours de traitement. » De petites épidémies ont éclaté ces derniers années dans le secteur, autant d’alertes pour les autorités sanitaires, qui proposent d’ailleurs à nouveau la vaccination des nourrissons en Île-de-France : une vingtaine de cas dans un quartier de Clichy-sous-Bois en 2011, un début d’épidémie à Saint-Denis, dans un lycée puis un hôpital. Début juillet, 29 cas d’infection de tuberculose latente ont été dépistés dans un collège à Évry, au sud de Paris. « Le bacille est toujours là. Partout où il y a des poches de précarité forte, il y aura de la tuberculose », affirme Jeanine Rochefort.
À l’étranger, aux portes mêmes de l’Europe, la tuberculose reste un fléau majeur : en 2011, 8,7 millions de personnes ont été touchées et 1,4 million en sont mortes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime que c’est « l’une des maladies dues à un agent infectieux unique les plus meurtrières au monde ; elle se situe en seconde position juste après le VIH/sida ». L’Inde, la Chine, l’Afrique et l’ex-URSS sont particulièrement vulnérables.
La tuberculose est symptomatique de ces maladies qui cumulent les handicaps : 95 % des décès arrivent dans les pays en voie de développement et elle touche une population non-solvable et peu mobilisée ; le vaccin, mis au point au début du XXe siècle, est ancien, il protège surtout les enfants des formes sévères de la maladie ; enfin les traitements, selon Francis Varaine, spécialiste de la question pour Médecins sans frontières (MSF), sont « longs, toxiques et peu efficaces ». Eux aussi n’ont pas connu de réelle innovation depuis un quart de siècle et souffrent du désintérêt des laboratoires pharmaceutiques. « Globalement, la tuberculose a disparu de nos préoccupations, on n’a plus fait de recherche sur cette question, ajoute Francis Varaine. Il ne faut donc pas s’étonner que 60 ans après la découverte du dernier médicament anti-tuberculose, des résistances au traitement apparaissent. »
C’est le corollaire le plus inquiétant aux traitements vieillissants : la tuberculose s’est adaptée, contourne des médicaments souvent mal administrés ou mal consommés, a muté pour atteindre une forme résistante voire multirésistante aux différentes lignes de traitement. Pour le médecin, c’est une « épidémie en soi », catastrophique dans certains pays. En Biélorussie par exemple, un tiers des cas de tuberculose résistante surviennent chez des patients nouvellement infectés, n’ayant jamais reçu de traitement antituberculose auparavant. En Afrique du Sud, une forme ultrarésistante a touché 53 personnes en 2006. Un seul patient a survécu. En Russie et en Asie centrale aussi, ces tuberculoses ultrarésistantes gagnent du terrain.
- Voir le portfolio de Misha Friedman pour l’agence Cosmos publié sur Mediapart en septembre 2012.
Malgré ces points chauds et les alertes répétées de l’OMS et des ONG, il a fallu attendre 2013 pour voir enfin apparaître deux nouvelles molécules destinées à la lutte contre la tuberculose, développées par des laboratoires privées. Une vraie révolution dans ce domaine jusqu’ici en panne d’innovation. Mais une molécule ne fait pas un médicament… « On ne sait pas encore comment combiner ces deux découvertes dans un traitement, explique Francis Varaine. Les labos ne vont pas faire ce travail, ce n’est pas leur rôle et ils peuvent craindre de discréditer leur molécule dans un mauvais traitement. Il nous manque encore le cadre d’un nouveau régime thérapeutique. » La question du coût est aussi essentielle : actuellement, un traitement pour soigner une tuberculose résistante est estimé autour de 5 000 euros par patient, sans compter les frais d’analyses en laboratoire sur plusieurs mois, une petite fortune. Or le traitement doit être gratuit pour le patient, car la contagion potentielle pose un problème de santé publique.
Des pans entiers de la recherche orphelins
Troubles du vieillissement, maladies cardiovasculaires, cancers, mais aussi diabète, obésité, impuissance sexuelle… De nouvelles molécules sortent chaque année des laboratoires privés, mais rares sont celles destinées à traiter les maladies infectieuses. Et tant pis pour les pays pauvres ou les pauvres dans les pays de riches. Sur les 1 556 nouveaux médicaments approuvés entre 1975 et 2004, seuls 1,3 % d’entre eux étaient spécifiquement développés pour lutter contre les maladies tropicales ou la tuberculose, même si ces pathologies conduisent à 11,4 % de la morbidité mondiale, selon l’organisation DNDI (Drugs for Neglected Diseases initiative). Il y a dix ans, l’OMS estimait déjà que ces maladies « négligées », à l’instar de la fièvre noire, de la maladie du sommeil ou encore de la maladie de Chagas, ne figuraient pas « en très bonne place sur l’agenda mondial des R&D (recherche et développement) ». « Tous les huit mois, une nouvelle maladie infectieuse apparaît et rejoint la liste de celles qui touchent déjà une personne sur six dans le monde », pointait l’Organisation de développement et de coopération économique (OCDE), dans un rapport de 2010.
L’an dernier, l’ONU a sonné de nouveau le toscin, prenant acte du manque d’engagement de l’industrie pharmaceutique sur cette question. Mais au sein des « Big pharmas », la logique financière tend à privilégier les domaines rentables. La logique brevetaire a également recentré l’innovation sur des médicaments promettant un fort retour sur investissement. « Même si les firmes s’en défendent, la recherche privée est déterminée par le marché et il faudrait vraiment être naïf pour croire l’inverse », affirme Sophie Chauveau, historienne et spécialiste des sciences et techniques. Sandrine Caristan, déléguée syndicale CGT-Sanofi à Montpellier, a des mots plus durs : « On confectionne de belles plaquettes où l’on nous bassine avec le bien du patient, mais ce sont des mensonges ! Je peux vous dire que l’industrie pharmaceutique a oublié des continents entiers ! »
Les partenariats public-privé (PPP) associant chercheurs publics, ONG, industrie pharmaceutique, bailleurs nationaux et internationaux, ont suscité beaucoup d’espoirs depuis le début des années 2000. « TB alliance » pour la tuberculose, « Medecines for malaria venture » pour la malaria, ou encore le « Drugs for Neglected Diseases initiative » sont des exemples de cette mobilisation en réseau du privé et du public. Plus de la moitié des projets de recherche de nouveaux médicaments pour des maladies négligées sont d’ailleurs menés en PPP. Mais sous-financés par des pouvoirs publics exsangues, dépendants des stratégies des philanthropes privés, ces alliances souffrent aussi de la frilosité de l’industrie pharmaceutique à s’impliquer suffisamment tôt dans le développement du médicament. « Les laboratoires attendent de voir se préciser des perspectives de développement industriel. (…) Intégrant cette logique, les PPP sélectionnent les projets de recherche en fonction des possibilités réelles d’innovation, c’est-à-dire en fonction de l’intérêt qu’ils pourraient susciter chez les industriels, notait la chercheuse Hélène Fournols en 2011, dans un ouvrage consacré à la Santé internationale édité par Sciences-Po. Si le profit n’est pas la motivation des PPP, la logique reste celle de la rentabilité, en particulier quand les financements manquent, ce qui limite la prise de risques et peut contribuer à rétrécir le champ du possible de l’innovation. »
Si des domaines entiers de recherches deviennent orphelins, ce n’est pas simplement parce que les grands groupes se soucient plus ou moins de certaines maladies, « c’est aussi lié à la demande de l’opinion publique », tempère Bernard Meunier, membre de l’Académie des sciences. « C’est une question de rapport de force et de groupes de pression. Qui parle de la bilharziose ? Deux cents millions de personnes dans le monde sont atteintes par cette maladie. Le jour où deux cents journalistes occidentaux auront été touchés car ils auront mis les pieds dans le Nil, on en parlera peut-être… En attendant, une seule molécule existe depuis 40 ans et on sent monter les résistances. »
L’implication des malades du sida est un bon exemple de l’efficacité de la mobilisation des patients. Elle a eu pour effet de mettre la pression sur les laboratoires pour accélérer la création de traitements, mais également permettre une politique tarifaire différenciée selon les pays. Dans l’Hexagone, bien qu’invisibles, les malades de la tuberculose sont donc des appels à la vigilance.
La boîte noire :Mathilde Goanec est journaliste indépendante et signe régulièrement dans Mediapart. Elle avait réalisé l’an passé une série de cinq articles : « L’enfance sans parents » à retrouver ici ; et en 2011, une série de quatre articles : « Le Spitzberg, l’île de toutes les semences du monde », à retrouver là.